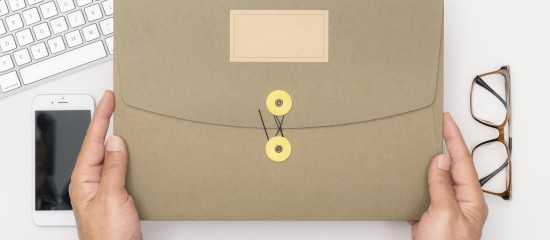À compter du 1er janvier 2025, et à titre expérimental pendant une durée de 4 ans, un certain nombre de tribunaux de commerce sont remplacés par des « tribunaux des activités économiques » (TAE) ayant une compétence élargie, notamment en matière de prévention et de traitement des difficultés des entreprises.
Au nombre de douze, ces tribunaux de commerce, qui sont donc devenus des TAE depuis le 1er janvier 2025, sont ceux d’Avignon, d’Auxerre, du Havre, du Mans, de Limoges, de Lyon, de Marseille, de Nancy, de Nanterre, de Paris, de Saint-Brieuc et de Versailles.
Compétence des tribunaux des activités économiques
Les compétences dévolues aux tribunaux judiciaires et aux tribunaux de commerce en matière de procédures amiables et collectives de traitement des difficultés économiques des entreprises sont transférées aux TAE. Ainsi, outre les compétences traditionnellement dévolues aux tribunaux de commerce, c’est-à-dire, en gros, régler les litiges entre commerçants ou entre sociétés commerciales, les TAE sont compétents pour connaître des procédures amiables (mandat ad hoc, procédure de conciliation, règlement amiable pour les exploitants agricoles) et des procédures collectives (procédure de sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire) dont font l’objet les entreprises en difficulté ayant leur siège dans leur ressort, et ce quels que soient leur statut (entreprise individuelle, professionnel libéral, société commerciale ou civile, groupement agricole, association) et leur activité (commerciale, artisanale, libérale, agricole).
Les TAE ont également vocation à connaître des actions et des contestations relatives aux baux commerciaux lorsqu’elles sont nées d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ou lorsqu’elles sont en lien avec une telle procédure.
Les procédures ouvertes à compter du 1er janvier 2025
Les procédures ouvertes à compter du 1er janvier 2025, et pendant la durée de l’expérimentation de 4 ans, relèvent donc désormais des TAE.
Parallèlement, les tribunaux judiciaires dont le ressort correspond à celui des douze TAE cessent d’être compétents pour les procédures concernées. Les sociétés civiles, les professionnels libéraux, les exploitants agricoles à titre individuel, les sociétés civiles d’exploitation agricole et les groupements agricoles (Gaec, GFA) ainsi que les associations, qui, jusqu’alors, relevaient des tribunaux judiciaires, doivent donc saisir le TAE pour demander l’ouverture d’une procédure amiable ou collective.
Exception : les professions libérales réglementées du droit (avocats, notaires, commissaires de justice, greffiers des tribunaux de commerce, administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires) continuent à relever des tribunaux judiciaires.
Quant aux commerçants et aux artisans qui exercent leur activité sous la forme d’entreprise individuelle ou de société commerciale, rien ne change pour eux si ce n’est que le tribunal auquel ils doivent s’adresser pour leurs difficultés économiques a changé de nom (le TAE au lieu du tribunal de commerce).
Le paiement d’une contribution financière
L’entreprise qui saisit le TAE doit payer une contribution financière lorsque la valeur totale de ses prétentions est supérieure à 50 000 €. À défaut, sa demande sera déclarée irrecevable.
Sachant que les entreprises employant moins de 250 salariés ne sont pas redevables de la contribution. Il en est de même pour le ministère public, l’État et les collectivités locales.
La contribution n’est pas due non plus lorsque la demande porte sur l’ouverture d’une procédure amiable ou collective ou encore lorsqu’elle est relative à l’homologation d’un accord amiable pour un différend ou d’une transaction.
En pratique : le versement de la contribution s’effectue au guichet du greffe ou par voie dématérialisée sur le site www.tribunaldigital.fr.
Variable selon qu’il s’agit d’une personne morale ou d’une personne physique, le montant de la contribution financière a été fixé comme suit :
| Montant du chiffre d’affaires annuel moyen sur les 3 dernières années (en millions d’euros) | Montant du bénéfice annuel moyen sur les 3 dernières années | Montant de la contribution |
|---|---|---|
| Supérieur à 50 et inférieur ou égal à 1 500 | Supérieur à 3 M€ | 3 % du montant de la valeur totale des prétentions et dans la limite d’un montant maximal de 50 000 € |
| Supérieur à 1 500 | Supérieur à 0 | 5 % du montant de la valeur totale des prétentions et dans la limite d’un montant maximal de 100 000 € |
| Revenu fiscal de référence (tel que défini au 1° du IV du CGI) par part | Montant de la contribution |
|---|---|
| Supérieur à 250 000 € et inférieur ou égal à 500 000 € | 1 % du montant de la valeur totale des prétentions et dans la limite d’un montant maximal de 17 000 € |
| Supérieur à 500 000 € et inférieur ou égal à 1 M€ | 2 % du montant de la valeur totale des prétentions et dans la limite d’un montant maximal de 33 000 € |
| Supérieur à 1 M€ | 3 % du montant de la valeur totale des prétentions et dans la limite d’un montant maximal de 50 000 € |