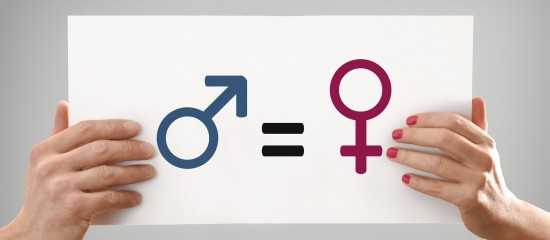En principe, les employeurs ne peuvent pas permettre à leurs salariés de prendre leurs repas dans les locaux affectés au travail. En outre, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le local dédié à la restauration doit contenir plusieurs équipements comme des sièges et des tables en nombre suffisant, un robinet d’eau potable, un moyen de conservation ou de réfrigération des aliments, etc.
Toutefois, en raison de l’épidémie de Covid-19 qui perdure sur le territoire, si le local habituellement dédié à la restauration ne permet pas de respecter les règles liées à la distanciation physique entre les salariés (au moins 2 mètres entre chaque personne en l’absence de port du masque), l’employeur est autorisé à définir un ou plusieurs emplacements de restauration dans les lieux affectés au travail. Cet emplacement pouvant ne pas comporter les équipements habituellement exigés.
Exception : l’emplacement de restauration ne peut pas être situé dans les locaux comportant l’emploi ou le stockage de substances ou mélanges dangereux.
Cette mesure, qui avait déjà été mise en place durant plusieurs mois l’an dernier, s’applique du 27 janvier au 30 avril 2022. Sachant que le gouvernement pourra, en fonction de l’évolution de la situation sanitaire, la faire perdurer jusqu’au 31 juillet 2022.
En pratique : en temps normal, les entreprises de moins de 50 salariés qui souhaitent installer un emplacement de restauration dans les lieux affectés au travail doivent adresser une déclaration préalable à l’inspecteur du travail et au médecin du travail. L’obligation d’effectuer cette déclaration est suspendue jusqu’au 30 avril 2022.
Pour aider les employeurs à lutter contre la propagation de l’épidémie dans les emplacements dédiés à la restauration, les pouvoirs publics ont publié, sur le site du ministère du Travail, une fiche pratique baptisée « Covid-19 : organisation et fonctionnement des restaurants d’entreprise ».